Alerte environnement: Le drame de Oued El Harrach met à nu une des pires catastrophes écologiques qui passe sous silence
- gherrrabi
- 21 août
- 6 min de lecture

Le pire, c'est le bruit du silence
Le problème de l'environnement est une source d'inquiétude dans le monde, à cause des désastres écologiques dus aux multiples formes de pollution. Le mercure reste l'élément le plus dangereux répertorié à ce jour, particulièrement en amont de l'oued et lors des crues en baie et au port d'Alger.Le drame de Oued El Harrach
En Algérie, tous les regards réprobateurs sont plus que jamais rivés sur le régime algérien. Il est cette fois-ci ouvertement accusé d’être le principal responsable de la mort de 18 personnes, tuées vendredi dernier, suite à la chute d’un autobus bondé de passagers dans l’Oued El Harrach, un conduit d’eaux usées et d’immondices qui traverse plusieurs villes algériennes, dont la capitale, Alger. Pour cacher ce crime dû à son impéritie, le pouvoir algérien a réagi en rangs dispersés, mais a vite trouvé des boucs émissaires en sanctionnant, entre autres, des chaines de télévision ayant répercuté à chaud le ras-le-bol de la rue à travers des témoignages sur ce drame.
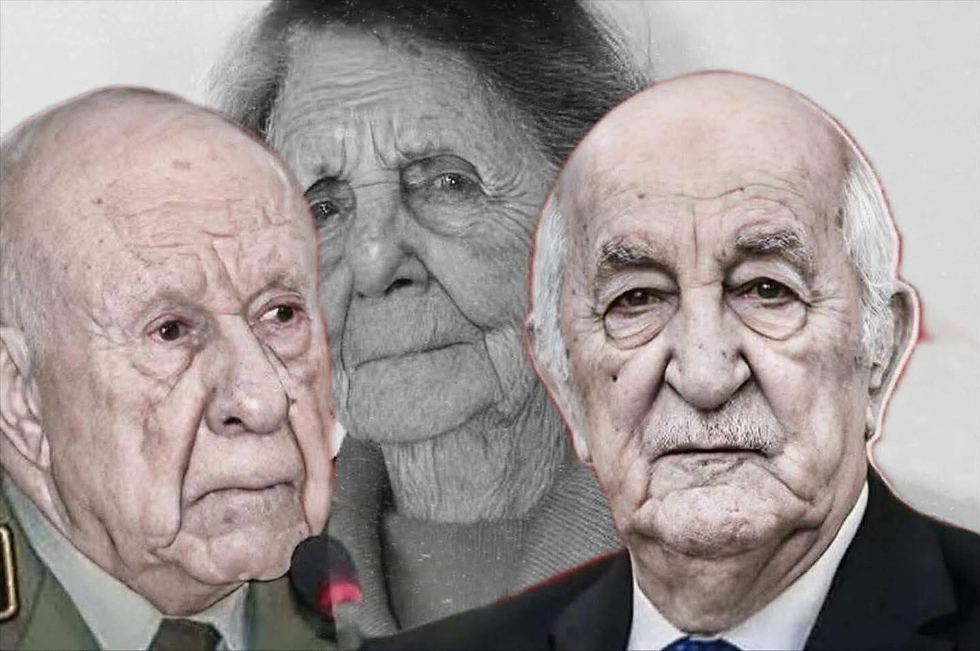
Dans «l’Algérie nouvelle», devenue depuis une année «l’Algérie victorieuse», les infrastructures de base existantes ont atteint des niveaux abyssaux de délabrement, au point d’exposer au danger permanent la vie des Algériens. L’exemple par le parc automobile local en dépérissement avancé sous l’effet des interdictions, ordonnées par Abdelmadjid Tebboune, d’importer des pièces de rechange, ou détachées. Résultat: des accidents de la route en série, faisant chaque année plusieurs milliers de morts et de blessés à travers tout le pays. Une hécatombe dont l’un des plus récents épisodes est le drame de vendredi dernier, consécutif à la chute d’un autobus du haut d’un pont enjambant le Oued Harrach, un égout à ciel ouvert. Cet accident a fait 18 morts et plus d’une vingtaine de blessés en plein cœur de la capitale.
Inhalation de substances polluées
Un médecin spécialiste en anesthésie et réanimation à l’hôpital Zemirli à Alger a révélé l’état de santé des victimes de l’accident de la chute de la navette dans l’oued El-Harrach.
Le médecin a précisé que l’hôpital a accueilli 25 blessés, pris en charge selon le protocole sanitaire en vigueur. Quatre d’entre eux ont été transférés au bloc opératoire, et cinq autres ont été dirigés vers l’hôpital militaire de Aïn Naâdja.
Par ailleurs, trois blessés ont été admis en service de réanimation, quatre ont été placés sous surveillance intensive, et dix sous surveillance classique.
Le médecin a ajouté que l’état des patients en réanimation est jugé « grave à très grave », en raison de l’inhalation et de l’ingestion de grandes quantités de substances polluées, affectant les poumons et l’estomac, ce qui nécessite des efforts considérables pour stabiliser leur état.
Le mercure reste l'élément le plus dangereux répertorié à ce jour, particulièrement en amont de l'oued et lors des crues en baie et au port d'Alger.
Il a également lancé un appel à toutes les personnes ayant participé aux premières opérations de sauvetage, les invitant à se rendre dans les établissements de santé pour effectuer des examens immédiats et réguliers, afin de prévenir toute complication future pouvant affecter le nez, la gorge, les poumons ou le cerveau.
L'oued El-Harrach est un fleuve algérien qui prend naissance dans l'Atlas blidéen près de Hammam Melouane. Il est long de 67 kilomètres et se jette dans la Méditerranée, en plein milieu de la baie d'Alger.
L'oued El-Harrach traverse la plaine de la Mitidja depuis Bougara et irrigue les zones agricoles tout autour, grâce notamment à ses affluents et canaux, les oued Djemâa, Baba Ali, El Terro, et Semar qui traverse une zone industrielle de la banlieue est d'Alger.
Son principal affluent est l'oued El Kerma qui grossit le volume du fleuve grâce aux eaux descendues du sahel algérois.
L'oued El-Harrach a un débit moyen de (4 à 5 m3 s−1) mais celui-ci peut monter jusqu'à (3 000 m3 s−1) en temps de crue.
Autrefois prisé des pécheurs, il est devenu aujourd'hui extrêmement pollué, il dépasse de 30 fois les normes acceptées et 400 fois les normes de l'OMS. En effet, il traverse sur ses 9 derniers kilomètres, jusqu'à son embouchure, un important tissu urbain et industriel (ZI de Baba Ali, ZI Gué de Constantine et ZI El-Harrach) qui déversent leurs rejets chimiques et leurs eaux usées.
La pollution du fleuve menace désormais la baie d'Alger, puisqu'en 2005 une étude menée par le japonais Mitsuo Yoshida a découvert du plomb, du chlore, du zinc et du chrome en forte quantité rejetés dans la mer.Depuis plusieurs années les pouvoirs publics tentent d'atténuer ou de résorber la pollution de l'oued mais jusqu'à aujourd'hui rien de concret n'a été effectué mis à part un masquage chimique des odeurs au niveau de l'embouchure, appelé opération jasmin, confiée à Suez Environnement.
Plusieurs dizaines de milliards qui partent en fumée
Le 13 juin 2012, l'APS annonce le lancement officiel des travaux de dépollution par le groupement algéro-coréen (Cosider-Daewoo Constructions) pour un montant total de 38 milliards de Dinars.

Il s'agit d'un projet de requalification du fleuve sur 18 km depuis son embouchure jusqu'au croisement de son affluent l'oued Djemaa entre Baraki et Sidi Moussa. La largeur de l'oued est recalibrée, les berges sont aménagées avec des promenades, des jardins et des parcs urbains.
De la rivière vivante à l’égout à ciel ouvert
Selon les experts, la dépollution définitive du fleuve exige encore 10 à 15 milliards de dinars supplémentaires et un plan d’urgence ciblé sur El Harrach et son embouchure — deux véritables “points noirs”. Une enveloppe qui reste à la portée de l’État, qui a déjà dépensé bien davantage pour des projets d’embellissement de la capitale, souvent sans résultats tangibles.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’Oued El Harrach restait relativement propre : on y pratiquait l’irrigation, la pêche et la baignade, et l’on y trouvait moulins hydrauliques et faune aquatique abondante.La situation change progressivement avec le développement urbain: la colonisation voit la construction de ponts, de routes et la création de la grande zone industrielle de la “Maison Carrée” (aujourd'hui. El Harrach) a vu s’installer certaines activités industrielles : abattoirs, tanneries, petites usines (notamment liées à la transformation agricole et à l’artisanat), et quelques manufactures implantées autour des voies ferrées et du port d’Alger.
Les abattoirs de Maison Carrée étaient déjà réputés pour leurs nuisances olfactives et leurs déversements, mais il s’agissait d’une pollution beaucoup plus localisée et limitée. A l’indépendance, l’État a choisi de développer l’industrie lourde et de masse sur ces mêmes sites où les infrastructures et la proximité d’Alger facilitaient l’installation des grandes zones industrielles (El Harrach, Rouiba, Réghaïa…).
Ces anciennes zones d’activités sont ainsi devenues les noyaux de l’industrialisation rapide planifiée dans les années 1970 et 1980, engendrant la problématique de pollution qu’on connaît aujourd’hui.
On recense aujourd’hui près de 174 unités industrielles installées sur son bassin. Parmi les plus polluantes : les tanneries d’El Harrach, les huileries d’Oued Smar, les ateliers mécaniques du Gué de Constantine, ou encore la cimenterie d’El Karma.
Le drame de Oued El Harrach met à nu une des pires catastrophes écologique aux conséquences humaines, environnementales ou économiques désastreuses
L'Algérie est l'un des pays touché par cette pollution, cela interpelle la mobilisation de tout citoyen. Cependant, l'urbanisation non-contrôlée des bassins versants et la présence de sites industriels à risque élevé, proche des concentrations urbaines, ont généré des pollutions et des dégradations considérables, qui ont mis en péril l'environnement et par conséquent la santé publique.
La distribution des métaux lourds dans le sédiment marin de la baie d'Alger, issue de l'oued El Harrach est régie par plusieurs facteurs: les caractéristiques des sédiments comme la granulométrie, la teneur en matière organique et la localisation des sources de pollution.
Une grande partie des berges est occupée par des usines métallurgiques qui génèrent beaucoup de métaux lourds et des dépotoirs. La fraction fine du sédiment piège un nombre important de métaux lourds, lors des crues ces éléments en trace (ETM) charriés par l'Oued El Harrach se jettent en mer ou la dérive littorale et le phénomène de floculation (Chester et Stoner, 1985) et de décantation se charge de la distribution de ces dépôts dans la baie. Les analyses des métaux lourds suivants : Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, Fe, Pb et le Hg ont permis de mettre en évidence dans un premier temps, une association de trois éléments en trace à savoir Zn, Pb et Cu qui représentent un taux de contamination important dans la baie d'Alger. Le mercure reste l'élément le plus dangereux répertorié à ce jour, particulièrement en amont de l'oued et lors des crues en baie et au port d'Alger.




![Le Maroc se positionne comme un acteur engagé et un porte-voix des victimes du terrorisme en Afrique... [Décryptage] - By- Gherrabi Mohammed](https://static.wixstatic.com/media/f0d73a_5560e4e9e3db4277a707af80d307e424~mv2.png/v1/fill/w_406,h_176,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/f0d73a_5560e4e9e3db4277a707af80d307e424~mv2.png)


Commentaires